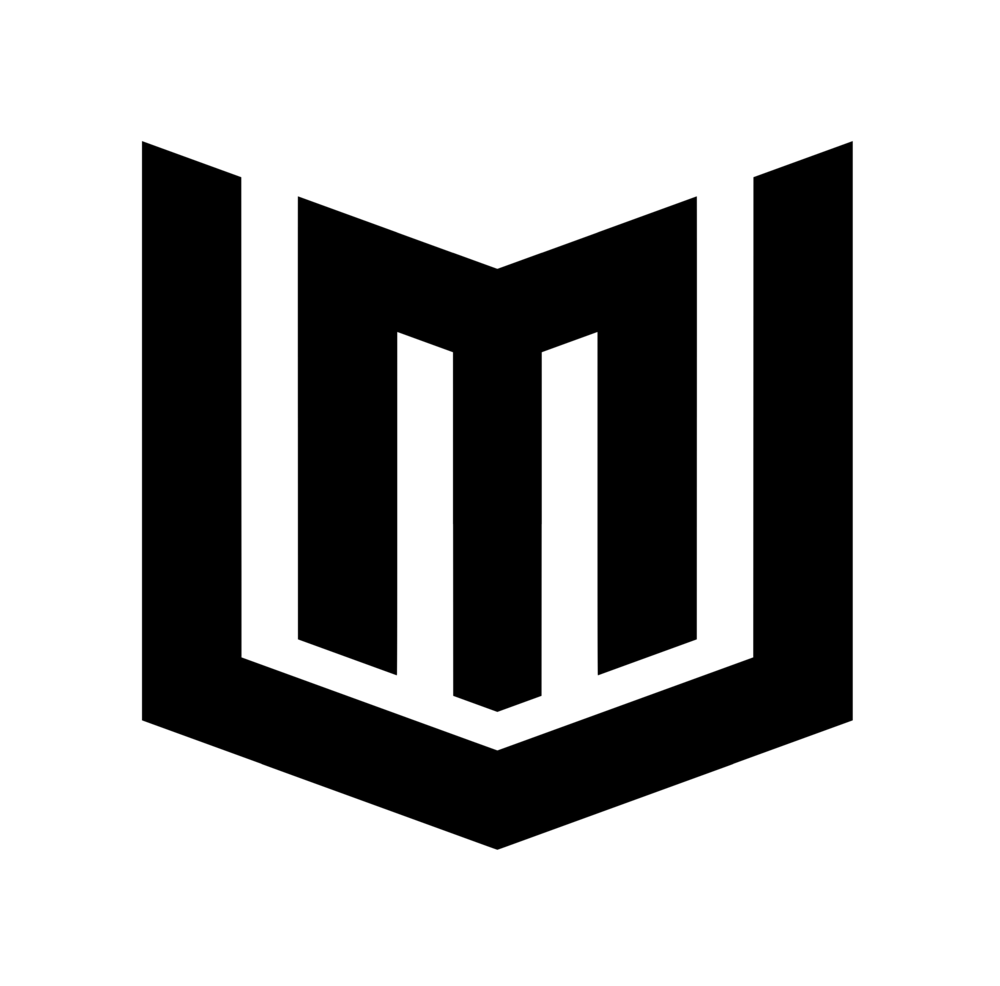La Véritable Histoire du Calisthenics
Le Calisthenics, aussi appelé « Street Workout », est une discipline moderne qui a su conquérir le monde du sport ces dernières années. Né (ou plutôt redécouverte mais ça on va le voir par la suite) d’une volonté de se s’entraîner différemment, généralement à l’aide du mobilier urbain, il repose sur un principe simple : utiliser son propre poids pour développer force, endurance, agilité et contrôle.
Imaginé comme une alternative plus libre et créative à la musculation classique, le Calisthenics s’inspire de plusieurs univers, de la gymnastique à la musculation en passant par les arts du cirque et les sports de force. On distingue aujourd’hui trois grandes catégories : le Freestyle (axé agilité et figures statiques), le Set & Reps (centré sur l’endurance et la répétition), et le Street Lifting (focalisé sur la force pure).
Pourtant, derrière son image moderne et urbaine, la discipline même du Calisthenics cache une histoire bien plus ancienne et surprenante…
Des racines antiques ? Vraiment ?
Soyons clairs dès le départ : contrairement à une idée largement répandue, il n’existe aucune preuve que les Grecs de l’Antiquité pratiquaient le Calisthenics tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Certes, ils s’entraînaient au poids du corps et pratiquaient ce qu’ils appelaient « gymnastique », mais leur conception et leurs exercices étaient très éloignés de nos figures modernes. Leurs entraînements consistaient principalement en disciplines comme le pugilat (une forme ancienne de boxe), la lutte, le lancer de javelot, le lancer de disque, la course ou encore les sauts. Autant d’activités athlétiques, mais aucune qui ne s’apparente réellement aux figures statiques ou dynamiques du Calisthenics moderne.
Cependant, leur approche globale du corps mérite d’être soulignée. Chez les Grecs, la gymnastique n’était pas qu’un simple divertissement ou une préparation militaire (même si cet aspect était central, comme l’illustrent les réformes de Lycurgue à Sparte, qui visaient à former des guerriers redoutables). Elle avait aussi une visée médicale, visant à renforcer la santé et à préserver un corps solide et actif. Les gymnases étaient d’ailleurs placés sous la protection d’Apollon, dieu de la médecine et des arts.
Enfin, l’entraînement avait également une dimension athlétique, dans la préparation aux compétitions des jeux panhelléniques, où la performance et l’excellence physique étaient glorifiées.
Ainsi puisque lancer un javelot ou combattre au pugilat n’a rien à voir avec un front lever ou une full planche, on ne peut donc pas affirmer que le Calisthenics descend directement de la gymnastique grecque antique.
En revanche, il est indéniable que l’idéal grec du corps fort, souple, agile et harmonieux a profondément influencé l’esprit de la gymnastique européenne moderne et, par la même occasion, celui du Calisthenics. Une recherche d’excellence et de maîtrise du corps qui continue, encore aujourd’hui, à nous inspirer.


Renaissance de la gymnastique
Aux origines de la gymnastique moderne
Il faut attendre la fin du XVIIIᵉ siècle pour assister à la véritable naissance de la gymnastique moderne. C’est à cette époque que la réflexion sur l’importance de l’activité physique refait surface en Europe, portée par des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, John Locke ou Johann Heinrich Pestalozzi, qui soulignent le rôle essentiel du mouvement dans l’éducation du corps et de l’esprit.
Tout converge alors vers l’école de Schnepfenthal, en Allemagne, fondée par Christian Gotthilf Salzmann. Précurseur de l’éducation physique, Salzmann y applique des méthodes pédagogiques innovantes et jette les bases d’une approche structurée de l’exercice corporel.


C’est dans ce contexte que Johann Christoph Friedrich Guts Muths, considéré aujourd’hui comme le « père de la gymnastique moderne », se distingue. En 1793, il publie Gymnastik für die Jugend, un ouvrage fondateur qui systématise les exercices corporels et en propose une véritable méthode. Il distingue déjà à l’époque les exercices dits « naturels » — destinés à fortifier et entretenir le corps — et les exercices « non utilitaires » ou « artificiels », qui inspireront plus tard la gymnastique rythmique.
Les bienfaits du mouvement n’étaient pas une idée nouvelle : ils étaient déjà valorisés par les Grecs anciens et repris par des médecins et intellectuels tels que Clément Joseph Tissot ou Girolamo Mercuriale. Mais Guts Muths propose pour la première fois une organisation pédagogique accessible et reproductible.




Sa méthode est révolutionnaire et va inspirer toute une génération d’éducateurs à travers l’Europe. Des figures comme Francisco Amoros en France, Franz Nachtegall au Danemark, Friedrich Ludwig Jahn en Allemagne, Adolf Spiess en Suisse ou encore Phokion Heinrich Clias, s’approprient ces idées et contribuent à diffuser la gymnastique moderne sur tout le continent. De véritables « apôtres » de la gymnastique, qui préparent le terrain pour l’essor du Calisthenics que l’on connaît aujourd’hui.





La Gymnastique suédoise
Dans cette effervescence européenne autour de l’éducation physique, une autre approche majeure voit le jour en Suède, portée par Pehr Henrik Ling. Considéré comme le père de la gymnastique suédoise, Ling développe au début du XIXᵉ siècle une méthode qui aura une influence considérable, non seulement en Europe, mais aussi jusqu’aux États-Unis.
Contrairement à l’école allemande de Jahn, centrée sur la performance athlétique et la préparation militaire, la gymnastique suédoise propose une vision plus holistique et thérapeutique. L’objectif n’est pas seulement de renforcer le corps, mais de promouvoir la santé, d’améliorer la posture et d’harmoniser l’ensemble des fonctions corporelles.
Cette approche est profondément ancrée dans une démarche scientifique. Ling, passionné d’anatomie et de physiologie, conçoit des exercices précis, actifs, passifs, incluant flexions, rotations, percussions et mobilisations. Chacun est pensé pour agir sur des fonctions physiologiques spécifiques, telles que la circulation, la tonicité musculaire ou encore la régulation du rythme cardiaque.
Peu à peu, la gymnastique suédoise devient une véritable institution. Elle s’impose dans les écoles et l’armée suédoises, où elle est valorisée pour sa méthodologie claire, sa douceur et son accessibilité. Ling forme de nombreux instructeurs qui diffuseront ensuite son système dans toute l’Europe, et même outre-Atlantique.
Il est essentiel de comprendre cette branche, car le terme « gymnastique suédoise » est souvent — parfois à tort — associé au Calisthenics. Pourtant, son influence est indéniable : elle a contribué à poser les bases d’une pratique corporelle structurée et accessible, qui reste aujourd’hui au cœur de l’esprit du Calisthenics moderne.


Gymnastique et Calisthenics
Maintenant qu’en est-il de la naissance du Calisthenics au sens strict ?
L’apparition du terme « Calisthenics » est directement liée à une figure clé de l’histoire de la gymnastique : Phokion Heinrich Clias. Passionné par ce qu’il appelait la somascétique (du grec ancien, « celui qui entraîne son corps »), Clias voyait dans cette discipline un formidable outil pour améliorer la santé et développer la force physique.
Ainsi, après avoir contribué à la diffusion de la gymnastique aux Pays-Bas (1806-1808), en Allemagne (1809-1810), puis en Suisse (1811-1814), il publie ses premiers ouvrages dès 1816. Il y détaille une série de mouvements inspirés notamment de Guts Muths et Jahn. Sa réputation grandissant, il est appelé en Angleterre en 1821, où il est nommé « Capitaine Surintendant des exercices somascétiques pour l’armée et la marine » par la cour britannique. Et très vite, sa méthode séduit et se répand dans la société.
Jusqu’au jour où les dames de la cour de la duchesse de Wellington entendirent parler de cette approche et demandent à l’adapter pour l’éducation physique des jeunes filles. Soutenu par les médecins de l’époque, Clias développe alors une version plus douce et gracieuse de la gymnastique, spécifiquement destinée aux femmes. C’est dans ce contexte que naît le terme Calisthenics, qui vient du grec kalos (beauté) et sthenos (force). Le terme kalos faisant ainsi surtout référence à des notions comme la féminité et la grâce.
En 1827, trois ouvrages paraissent à Londres et marquent l’essor du Calisthenics :
et On the Utility of Calisthenic Exercise de Marian Mason.



Par ailleurs, cette dernière n’était pas n’importe qui : Marian Mason est considérée comme la première coach de fitness au Royaume-Uni, et probablement du monde. La première coach était une professeure de Calisthenics, avant tout !
L’approche du Calisthenics de cette époque est résolument tournée vers la douceur, la fluidité et l’élégance. Pourtant, certains éducateurs comme Beaujeu n’hésitent pas à introduire des exercices plus exigeants, comme les tractions pour les femmes dès 1828 — une idée particulièrement novatrice pour l’époque.


Gymnastique de Beaujeu. © Domaine public
Enfin, aux côtés de Jahn, Clias a été l’un des premiers à formaliser des mouvements qui figurent aujourd’hui parmi les incontournables du Calisthenics moderne.
Apparition des premiers mouvements
La première description historique d’un mouvement qui s’apparente aux pompes modernes remonte à 1819, dans l’ouvrage Gymnastique élémentaire de Phokion Heinrich Clias. Il y décrit l’exercice sous le nom très poétique (et technique) de « Baiser la terre en équilibre, sur les bras et la pointe des pieds ».
Dans ce même ouvrage, Clias mentionne aussi un mouvement ressemblant aux dips, dont on peut saluer l’amplitude incroyable qu’il préconisait déjà à l’époque, et qu’il décrit comme « toucher la terre avec les genoux ».



Mais Clias n’est pas le premier à avoir formalisé ces exercices. Avant lui, Friedrich Ludwig Jahn, souvent considéré également comme un des pères de la gymnastique moderne, avait déjà décrit des mouvements similaires.
Et pas n’importe quels mouvements : Jahn mentionnait des variantes de tractions, et allait même jusqu’à proposer des progressions pour la traction à un bras (one arm pull-up). Oui, tu as bien lu : en 1816, Jahn décrivait déjà le tout premier « tuto » sur la traction à un bras, en recommandant le travail d’isométrie et d’excentrique comme préparation.
Quant au muscle-up ? Jahn le décrivait aussi, bien que la technique laisse un peu à désirer… Il conseillait un fort balancement des jambes pour se hisser au-dessus de la barre. Une technique qui, disons-le, flirt avec le kipping et la no rep.
La révolution du Calisthenics
L’industrialisation de la gymnastique
Il faut attendre la Révolution industrielle pour assister à l’arrivée des premiers équipements en métal, comme les barres fixes, qui remplacent peu à peu les agrès en bois utilisés jusque-là. Bien entendu, de nombreux équipements en bois continueront d’être utilisés, mais cette transition marque une étape clé dans la modernisation de l’entraînement.
Durant le XIXᵉ siècle, on observe une véritable effervescence autour de la gymnastique, du calisthenics et, plus largement, de l’activité physique. De nombreux inventeurs et ingénieurs se lancent dans la conception d’appareils destinés à optimiser la préparation physique.
Parmi eux, le capitaine James Chiosso se distingue. Il est notamment l’inventeur de la première machine de musculation moderne, la polymachinion, dont le premier prototype voit le jour en 1829. En 1855, Chiosso publie un guide détaillant son utilisation, proposant une série d’exercices de renforcement : good morning, tirage vertical, pull-over, rameur, squats… Il va même jusqu’à préciser les groupes musculaires ciblés par chaque mouvement, une approche extrêmement novatrice pour l’époque.





Gymnastic Polymachinon (1855) — instructions d’exercices systématiques sur machine, par le capitaine Chiosso. © Domaine public
Dans le même esprit d’innovation, on voit apparaître en 1859 l’elastic calisthenics chest expander, considéré comme l’ancêtre direct de nos élastiques modernes. Ce système visait à améliorer la posture tout en introduisant une résistance progressive dans les exercices, déjà associé à ce qu’on appelait à l’époque le calisthenics.
Aujourd’hui, alors que les élastiques et les systèmes de résistance sont omniprésents dans les entraînements, on réalise que ces concepts n’ont, en réalité, rien de nouveau. La vision d’optimiser la force et la posture à l’aide d’outils innovants avait déjà pris racine au XIXᵉ siècle.


Cost’s System of Calisthenic Exercises (1859) — manuel d’exercices avec instruments élastiques, conçu comme guide pédagogique. © Domaine public
Popularisation du Calisthenics aux Etats Unis
À partir du milieu du XIXᵉ siècle, le calisthenics commence à s’implanter aux États-Unis, porté par des figures majeures comme Dio Lewis et Catharine Beecher. Leur approche s’inspire largement des travaux de Pehr Henrik Ling et de sa gymnastique suédoise. Tous deux reprennent le principe central de la thérapie par le mouvement, donnant au calisthenics une dimension avant tout médicale et hygiéniste. Dans leurs ouvrages, de nombreuses sections sont d’ailleurs consacrées à l’anatomie et à la physiologie humaine : pour eux, comprendre la structure du corps et le fonctionnement des organes était indispensable pour préserver la santé.


Dio Lewis, notamment, voyait dans le mouvement un véritable remède thérapeutique, particulièrement pour les maladies pulmonaires. Il recommandait des exercices variés : percussions pour stimuler la circulation sanguine, mobilisations thoraciques, ou encore des mouvements plus familiers aujourd’hui comme les tractions australiennes et les pompes sur anneaux.



Weak Lungs and How to Make Them Strong (1864) — traité de Dio Lewis sur le renforcement des poumons et la gymnastique thérapeutique. © Domaine public
Catharine Beecher, quant à elle, a joué un rôle déterminant dans la codification et la diffusion du calisthenics. Sa méthode restait cependant assez conservatrice et fidèle aux principes éducatifs de l’époque, considérant que certains exercices étaient trop « intenses » pour les femmes — contrairement à certains éducateurs européens qui n’hésitaient pas à leur proposer des tractions au poids du corps.



Physiology and Calisthenics (1858) — manuel de Catharine E. Beecher destiné aux écoles et aux familles. © Domaine public
Si tu t’es déjà demandé à quoi ressemblaient les premiers espaces dédiés au calisthenics, il faut imaginer les « calisthenics halls » théorisés par Beecher en 1856. Loin de nos parcs modernes, ils ressemblaient davantage à de grandes salles de danse. Dans son ouvrage, Beecher décrit précisément comment ces salles devaient être aménagées : de vastes espaces dégagés, 1,50 mètre d’écart entre chaque pratiquant, bien ventilés, et avec des allées périphériques pour marcher — car la marche était alors considérée comme une composante essentielle du calisthenics.



Vers la fin du XIXᵉ siècle, le calisthenics commence à décliner en Europe et en Russie. Aux États-Unis, la discipline survit plus longtemps, même si elle perd progressivement en popularité dès la guerre de Sécession (1861–1865). Assez paradoxalement, le terme « calisthenics » va subsister aux États-Unis, mais en prenant un nouveau sens : puisqu’il désigne désormais des exercices sans équipement, tels qu’on les entend encore aujourd’hui.
L’émergence du calisthenics moderne
Le Calisthenics militaire
La gymnastique très militaire de Jahn — aussi appelée système Turnen — et son engagement patriotique en Allemagne ont eu une forte influence sur les institutions militaires américaines à la fin du XIXᵉ siècle. C’est dans ce contexte que Herman Koehler, maître d’armes à l’Académie militaire des États-Unis, publie en 1892, sous l’autorité du département de la Guerre, son célèbre Manual of Calisthenic Exercises.

Koehler introduit ces entraînements physiques auprès des cadets de l’US Army. Les résultats, jugés excellents, conduisent à généraliser la méthode à l’ensemble des troupes. Son manuel devient rapidement une référence pour la préparation physique des soldats, proposant une grande variété de mouvements à réaliser de façon systématique et répétée.





Manuel officiel de calisthénie (Herman Koehler), publié par le War Department américain en 1892 © Domaine public
Par la suite, d’autres figures comme William H. Wilbur ont poursuivi et adapté la méthode de Koehler. Son ouvrage Koehler Method of Physical Drill, publié en 1920, contribue à diffuser encore davantage ces exercices au sein de l’armée et même au-delà du cadre strictement militaire.


Ainsi, le calisthenics, d’abord pensé comme un outil d’éducation physique, trouve progressivement une place centrale dans la formation des soldats, participant à poser les bases du calisthenics moderne que l’on connaît aujourd’hui.
Les premières compétitions
Eh bien, elles ne sont pas aussi récentes qu’on pourrait le croire.
Les premières mentions de ce genre de tournois, axés sur les performances athlétiques au poids du corps, remontent à la fin du XIXᵉ siècle. Dans le Sterling Daily Standard du 11 avril 1895, on trouve une petite section intitulée The Strongest Man. L’article y raconte l’exploit d’un étudiant de l’université d’Amherst, dans le Massachusetts (USA), nommé William Lane.


À première vue, William Lane n’avait rien d’un colosse : il mesurait 1,71 m pour 68,5 kg. Mais ce qui le distinguait, c’était sa force et son endurance exceptionnelles. Lors d’un tournoi organisé dans son université, il réussit à enchaîner 45 dips — déjà très impressionnant pour l’époque — mais surtout 48 tractions. Même aujourd’hui, ces performances restent rares et témoignent d’un niveau de maîtrise remarquable. Et le plus fou ? Il avait plus de tractions que de dips, un rapport quasi inédit même de nos jours.
Cette anecdote nous montrent que l’esprit de défi et la recherche de la performance au poids du corps existaient déjà bien avant l’essor du street workout contemporain et des compétitions actuelles.
Une culture physique populaire – Le cas du Daily Dozen
Au fil du XXᵉ siècle, le calisthenics s’ancre peu à peu dans la culture populaire. Son accessibilité, son coût très faible, la possibilité de s’entraîner partout et de l’intégrer facilement à un mode de vie actif expliquent en grande partie son succès.
C’est dans ce contexte qu’apparaissent les premiers programmes grand public. As-tu déjà entendu parler du Daily Dozen de Walter Camp ?
Créé pendant la Première Guerre mondiale par Walter Chauncey Camp — athlète et considéré comme le père du football américain — ce programme visait initialement à maintenir les soldats en forme sans les épuiser avant le combat.
Le Daily Dozen, composé de 12 exercices simples de calisthenics, connaît finalement un immense succès. À la fin de la guerre, le programme s’étend rapidement à la population civile. Dans les années 1920 et 1930, plus de 500 000 exemplaires sont diffusés, y compris sous forme de disques phonographiques ou même d’émissions radiophoniques, bien avant l’ère d’internet.


Durant tout le XXᵉ siècle, le calisthenics est perçu avant tout comme un échauffement, un outil d’entretien physique facile et rapide. Il s’impose comme une base de préparation physique dans de nombreux sports : boxe, baseball, football américain…
Et même à mesure que la musculation avec charges (weightlifting) se développait et gagnait en popularité, le calisthenics conservait sa place. On retrouve ainsi des figures emblématiques qui l’ont adopté : les boxeurs professionnels américains, des acteurs comme Harrison Ford, le mythique dragon flag popularisé par Bruce Lee, ou encore les handstand push-ups d’Arnold Schwarzenegger.
Malgré tout, en fin de siècle, l’intérêt pour le calisthenics décline peu à peu, à mesure que le weightlifting prend le devant de la scène aux États-Unis.
Don’t forget the Calisthenics
Aujourd’hui, le calisthenics n’est plus associé à la simple idée de « grâce » ou de « beauté » comme à ses débuts. Il s’impose désormais comme une méthode d’entraînement complète au poids du corps, reposant sur des mouvements fondamentaux tels que les pompes, les tractions, les dips, les exercices pour les abdos ou encore les squats.
Même si certains la considèrent parfois comme plus « limitée » comparée à la musculation avec charges, cette pratique offre un développement corporel naturel, harmonieux et fonctionnel. Et comme le résumait parfaitement George Foreman, légende de la boxe anglaise : « Calisthenics may take longer than lifting weights but they worked before weights and they work now. » (« Le calisthenics peut prendre plus de temps que les poids, mais ça fonctionnait avant les poids, et ça fonctionne encore aujourd’hui. » ).
Les pionniers du Street Workout
Au début des années 2000, un nouveau mouvement venu tout droit des États-Unis fait son apparition : le Street Workout. Ce « calisthenics de rue » consiste à s’entraîner en utilisant le mobilier urbain — barres, bancs, structures publiques — pour transformer l’environnement en terrain d’entraînement et de renforcement.
Les premiers à populariser cette approche sont les Ruff Ryders, qui publient en 2002 un DVD culte : Thug Workout, sous-titré « la musculation de la rue ». Leur message est simple et percutant : oui, on peut s’entraîner efficacement et se forger un physique solide sans équipement sophistiqué et avec peu de moyens. Une philosophie fidèle à l’esprit originel du calisthenics.

Dans la foulée, le mouvement prend de l’ampleur grâce aux Bartendaz, qui combinent entraînement, esprit communautaire et actions humanitaires. Leur approche introduit progressivement une dimension plus créative, annonçant les prémices du Street Workout freestyle, où l’esthétique et la performance se rejoignent.
Dès 2008, les premières compétitions officielles voient le jour, marquant un tournant pour la discipline. Des équipes emblématiques émergent : B-Xtreme, Harlem S.E.A.L.S., Highlandaz, Calisthenic Kingz, Beastmode, Barbarians, Barstarzz… Des noms qui vous sont peut-être familiers.

La diffusion massive sur YouTube accélère le phénomène et révèle des figures devenues iconiques. Parmi elles, Hannibal For King, considéré comme le « père du Street Workout », mais aussi Chris Heria, Frank Medrano, Dennis (Baristi Workout), ou encore les Bar Brothers.
Le Calisthenics aujourd’hui
En 2011, le Calisthenics franchit une étape décisive avec la création de sa première fédération officielle : la World Street Workout & Calisthenics Federation (WSWCF). Depuis, elle organise chaque année les championnats du monde de Street Workout Freestyle, donnant à la discipline une visibilité internationale et un cadre structuré.

Depuis, le Calisthenics n’a cessé d’évoluer, de se diversifier et de se professionnaliser. La diffusion massive sur les réseaux sociaux a joué un rôle déterminant, accélérant l’évolution technique et attirant de nouveaux passionnés aux quatre coins du monde. Pourtant, malgré son succès grandissant, le Calisthenics reste encore jeune : il souffre d’un manque d’harmonisation, sans standards universels vraiment reconnus, ce qui le rend parfois difficile à catégoriser pour les grandes instances sportives.
Au fil des années, on observe une véritable démocratisation de la discipline. Ce qui frappe, c’est la vitesse à laquelle le Calisthenics s’est développé ces dernières années. Grâce à la passion des athlètes, à l’engagement des associations et à la créativité des communautés, le Calisthenics continue de repousser ses limites.
Une chose est certaine : ce n’est que le début…
Pour aller plus loin
Revenir sur l’histoire du Calisthenics, c’est comprendre comment cette discipline a évolué en un peu plus de deux siècles, passant d’une gymnastique douce et éducative à une méthode d’entraînement complète, exigeante et créative.
Sa définition aura changé au fil des époques : tour à tour outil de santé, préparation militaire, ou simple exercice d’entretien, le Calisthenics s’est transformé pour devenir aujourd’hui un véritable art du mouvement et un symbole de maîtrise du corps.
Maintenant si tu souhaites en savoir plus sur la discipline, apprendre comment t’entraîner, découvrir des programmes adaptés à ton niveau et du coaching personnalisé afin développer ta pratique, maîtriser de nouvelles figures et te perfectionner, tu pourras retrouver de nombreuse ressources sur le site de la Muscle-Up Academy.
Et pour explorer encore plus l’évolution et la richesse de cette discipline, une vidéo dédiée est disponible sur notre chaîne YouTube, ainsi que les sources complètes de cet article :